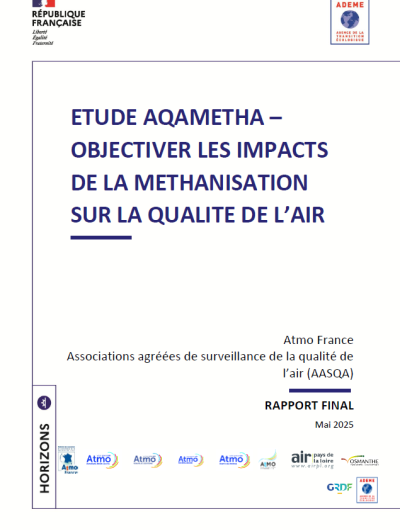02/09/2025
- Air extérieur
La filière de la méthanisation, en plein essor en France, contribue à la transition énergétique mais soulève des interrogations sur son impact sur la qualité de l’air et les odeurs. L’étude AQAMETHA a mesuré les concentrations d’ammoniac (NH3) et d’hydrogène sulfuré (H2S) sur 12 sites représentatifs de la filière nationale, et a mené des investigations olfactives via le Langage des Nez®.
Les résultats montrent que les concentrations en NH3 et H2S sont maximales en limite de propriété, mais diminuent fortement à proximité des habitations, et restent inférieures aux valeurs de références sanitaires. L’impact olfactif est perçu fortement dans un rayon de 200 m puis devient modéré jusqu’à 2 000 m selon les conditions météorologiques. La participation citoyenne a été freinée par des craintes d’acteurs locaux.
Des recommandations soulignent l’importance d’une communication continue avec les riverains et élus, et identifient le Langage des Nez® comme un outil au service de cette communication. Par ailleurs, une storymap interactive valorise ces résultats pour informer et accompagner l’expansion de la filière.
En France, la filière méthanisation, en plein essor, contribue à l’atteinte des objectifs nationaux de transition énergétique. Cette expansion suscite aussi des interrogations sur l’impact en termes de qualité de l’air à proximité des installations : la perception de cette composante peut diverger entre les porteurs de projet et les riverains. Dans ce contexte l’étude AQAMETHA a pour objectifs d’apporter à ces acteurs et au grand-public un panorama objectif et partagé de l’impact de la méthanisation sur des polluants cibles (l’ammoniac et l’hydrogène sulfuré) et les odeurs, et de tester l’apport d’un dispositif d’accompagnement et d’implication des riverains autour d’un projet d’unité de méthanisation en voie de mise en service.
Afin de répondre à ces objectifs, 12 unités de méthanisation ont été sélectionnées au niveau national selon des critères spécifiques répondant à un principe de représentativité du parc d’installations français. Une double approche a été effectuée par la mesure d’ammoniac (NH3) et d’hydrogène sulfuré (H2S) d’une part, et par des investigations olfactives en utilisant le Langage des Nez® d’autre part.
- Les mesures de polluants se sont effectuées 4 semaines par unités, avec un pas de temps hebdomadaire
- Les investigations olfactives se sont déroulées au cours de 2 journées par unités réparties deux fois dans l’année
Les résultats montrent que :
- Les concentrations en NH3 et H2S sont les plus élevées en limite de propriété, avec une concentration moyenne respective de 12,5 µg/m3 et de 1 µg/m3. Dès les premières habitations sous les vents dominants, les concentrations en NH3 sont divisées par trois, et les concentrations en hydrogène sulfuré sont proches voire en-dessous des limites de quantification de l’appareil de mesure.
L’emprise odorante de la méthanisation peut se ressentir à une intensité qualifiée de forte dans les premiers 200 mètres autour du site, puis devient modérée à faible entre 200 et 2 000 mètres autour de l’unité, dépendamment des conditions météorologiques et de l’activité du site.
- La démarche d’accompagnement et d’implication n’a, quant à elle, pas pu être menée à son terme en raison de multiples freins parmi lesquels la crainte des exploitants et des élus de raviver ou de créer des tensions auprès des riverains.
- À la lumière de ces résultats, des préconisations sont effectuées à l’intention des exploitants et des porteurs de projet de méthanisation. Parmi ces préconisations, le maintien d’un canal de communication avec les riverains et les élus et considéré comme essentiel. A cet effet, le Langage des Nez® est identifié comme un outil pouvant être utilisé au service de cette communication afin de lever les freins précédemment cités.
- En réponse à cette demande de communication, l’ensemble des résultats détaillés ont été valorisés dans une storymap (données organisées en cartes et graphiques présentant un récit interactif) accessible aux exploitants, aux élus et au grand-public. Cet outil de datavisualisation pourrait être alimenté par un élargissement des investigations autour d’un plus grand nombre d’unités de méthanisation afin de renforcer la première approche statistique offerte par l’étude AQAMETHA.